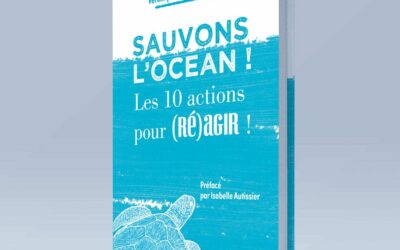Épisode 1 “Souci du vivant” | Vers un nouveau monde.
Bienvenue dans cette série audio consacrée aux soucis du vivant.
Je vais tenter de vous emmener avec moi dans la construction d’un nouveau monde respectueux du vivant. Mais qu’est-ce que j’entends par vivant ? Bien sûr, je nous inclue, nous, vivants humains, mais il y a aussi les non-humains, les animaux, les plantes, les champignons, les arbres, toutes formes de vie différentes de la nôtre. Mais j’englobe aussi tout ce qui semble inerte. Les sols, les rivières, les océans, les lacs, l’atmosphère… Car quand je parle du vivant, je pense d’abord à ce qu’on appelle les écosystèmes, c’est-à-dire tous les éléments pris individuellement, reliés par un réseau d’interactions et de relations qui rendent la vie possible, pérenne, dans un équilibre dynamique, prenant en compte les limites planétaires de la biosphère où nous sommes installés, la planète Terre ou la planète bleue. Le vivant est un terme que je préfère au mot nature ou environnement, ces deux-là étant connotés et créant un fossé entre nous, humains, et le reste du vivant, ou entre nous et le décor de vie dans lequel nous nous mouvons. Ce préalable étant exprimé, je me permets d’ajouter que l’ensemble de cette série de chroniques est inspirée textuellement par le livre de Marine Calmet « Devenir gardien de la nature » que je vous recommande, et que je remercie de m’avoir autorisé à reprendre ces textes et formulations tant elles sont proches de mon propos qui les ajustera.
Ce contenu est disponible au format texte et audio. Bonne lecture ou bonne écoute !
Fin de l’anthropocène
Nous allons vers un nouveau monde. Une révolution se prépare. En effet, à l’échelle d’une vie humaine, notre civilisation peut sembler ancienne, mais elle est en réalité très jeune comparée à l’émergence et au développement de la vie sur notre planète qui remonte à plusieurs milliards d’années. En un temps très bref, celui de ces derniers siècles, nous sommes entrés dans un modèle de libre-échange, de mondialisation, de capitalisme financier plus ou moins voilé selon les régimes politiques. Ce nouvel âge que l’on peut appeler Anthropocène ou Capitalocène passe sous silence l’aggravation des inégalités et des dégâts sociaux et environnementaux et rend difficilement concevable d’autres modèles de société. Façonnés par notre culture, formatés par notre éducation, nous avons les plus grandes difficultés à imaginer notre civilisation avec un regard extérieur, comme pourrait le faire un étranger visitant la France pour la toute première fois, étonné par notre façon de faire société, par nos manières et nos coutumes. Comment expliquer que nous ayons par exemple érigé la propriété privée au rang de principes sacrés alors que d’autres sociétés ont choisi de protéger les communs, c’est-à-dire ce qui appartient à tous, l’air, l’eau, les sols, etc. Cela afin de permettre la transmission d’un environnement sain, propice au développement harmonieux du vivant dans toutes ses composantes, humains et non-humains compris. Dans le monde occidental, l’individualisme est considéré comme émancipateur. Pourquoi ? Pour analyser les germes et les mécanismes de cette évolution, revenons à nos textes fondateurs auxquels appartient la Déclaration de l’Homme et du Citoyen de 1789. Dans une société profondément inégalitaire, alors même que l’esclavage était toujours pratiqué dans les colonies et qu’au sein des foyers les femmes étaient privées des mêmes droits que leur mari, ce texte, écrit par des hommes blancs issus des classes privilégiées, a défini ce qu’on a appelé les droits naturels de l’homme, parmi eux la liberté, l’égalité, la propriété. Avec un système reposant sur la reconnaissance des droits et libertés individuels, notre société fait passer au second plan la question de la protection du collectif, celui qui réunit les humains mais également les non-humains au sein de la communauté du vivant. Sur ces fondements, une culture de la compétition est instaurée, au détriment de la coopération, valorisant et encourageant les comportements qui profitent à l’individu au lieu de récompenser ceux qui profitent à la collectivité.
Les entreprises, un groupement humain à but lucratif
D’autres constructions juridiques sont apparues, prenant progressivement une place croissante dans notre société. Les entreprises, groupements humains à but lucratif, dotés de droits propres, ont profité d’une évolution juridique qui montre aujourd’hui de dangereux dysfonctionnements. Tant les inégalités se creusent. Nos lois ont accordé aux entreprises des droits similaires à ceux des humains, le droit de propriété, la protection du secret des affaires, de l’image et de la réputation. Ces droits ont modifié le rapport de force et la place de ces structures dans notre société. Car bien qu’il s’agisse de groupements humains, les grosses entreprises n’ont rien d’un collectif visant le bien-être et la protection de l’ensemble de ses membres. Elles distribuent d’immenses profits, de manière inéquitable, entre dirigeants, actionnaires et parfois leurs employés. En 2016, les grands patrons du CAC 40 gagnaient en moyenne 119 fois le salaire moyen au sein de leur entreprise. En 2009, ce n’était que 97 fois le salaire moyen. Un écart croissant. A un tel niveau d’écart, ce n’est plus un problème de contrôle interne de la répartition des salaires, mais bien d’une transformation de la société qui a permis l’accaparement des richesses par une petite minorité appartenant à la classe dirigeante. Cette dernière ne se sent ni solidaire de ses salariés, ni solidaire de la société dans son ensemble. Ces entreprises ont acquis une place tellement stratégique que les rapports de force sont inversés. Elles peuvent s’imposer sur un territoire, imposer leurs décisions ou leurs objectifs en exploitant le besoin d’emploi ou leur maintien, en exploitant les ambitions des élus, les espoirs des populations, mais aussi les vides juridiques et l’absence de courage politique. L’absence de régulations et la primauté des considérations économiques sur la protection des droits humains et des communs qui ont permis l’exploitation à outrance de la nature compromettent désormais les conditions de vie sur Terre.
La catastrophe écologique à nos portes
Il faut donc, dès maintenant, établir des lois nouvelles respectueuses du fonctionnement biologique du monde vivant. La civilisation industrielle s’est bâtie à partir de la vision d’un monde constitué de ressources à exploiter. Et l’image de la réussite repose sur des résultats en termes de croissance et de profit. Elle récompense les conduites égoïstes, cupides, menant à la catastrophe écologique aujourd’hui annoncée par la grande majorité des scientifiques. Ce constat doit nous amener à remettre en question notre modèle de société et ses fondements. Et il ne s’agit pas ici de faire du rafistolage ou des retouches cosmétiques. Dans les textes fondateurs d’une société à venir, nous devons désormais inclure la communauté du vivant afin qu’elle ne soit plus exploitée au profit de quelques-uns mais qu’elle devienne le foyer commun dans lequel l’ensemble de l’humanité pourra s’épanouir. Il s’agit aussi de changer radicalement l’exercice du pouvoir en garantissant les droits des laissés-pour-compte, c’est-à-dire les non-humains.
Un nouveau basculement historique
C’est vers ce nouveau monde que nous devons bifurquer dans une révolution positive, créatrice et libératrice qui vise l’ensemble de notre édifice social. Et cela n’a rien d’utopique. L’humanité a déjà opéré de nombreux changements dans le passé. Souvenons-nous, l’Occident a eu une image du monde où tout était création divine, avec la Terre au centre de ce monde s’appuyant sur la Bible. Quand Galilée confirme la théorie de Copernic selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil, il balaie un ordre du monde organisé pour répondre aux prétentions nombrilistes des théologiens. Aujourd’hui, nous sommes à l’heure d’un nouveau basculement historique. Aujourd’hui, notre époque s’appuie sur les écrits des apôtres du libéralisme et du dogme de la croissance, sur les théories capitalistes qui nous font nous soumettre à la main invisible du marché. Notre modèle économique repose sur l’injonction de produire plus, donc d’extraire plus, d‘exploiter toujours plus dans le réservoir de ressources que représente la nature pour vendre toujours plus pour faire grimper les profits sans aucune considération pour la finitude de notre planète, nous amenant à l’incapacité de ce système à se survivre à lui-même. Ce modèle est erroné, comme l’était le modèle géocentrique du monde prôné par l’Église et dont Galilée a changé la représentation en un modèle héliocentrique. Aujourd’hui, nous avons déjà dépassé la plupart des limites de notre planète. Face à l’amplification de la destruction du monde vivant, à l’effondrement de la biodiversité, à l’accélération du réchauffement climatique, les experts tirent la sonnette d’alarme. La prise de conscience de l’incompatibilité de notre mode de vie avec la préservation du vivant se généralise. Le mythe de la croissance infinie sur une planète aux dimensions finies est obsolète. Et une nouvelle fois, nous devons faire une rupture dans notre représentation du monde. La révolution de notre siècle doit replacer les humains non plus au sommet, mais au sein de la communauté du vivant.
N’en déplaise à Descartes, nous ne sommes ni maîtres et possesseurs de la nature et du vivant, mais plutôt dépendants les uns des autres.
À nous, désormais, de bifurquer vers ce nouveau monde.